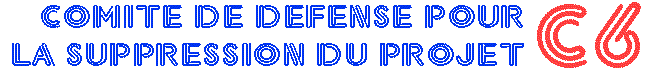 | 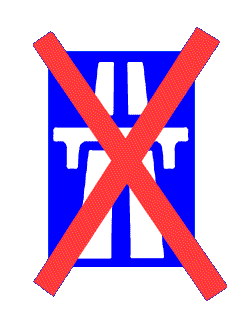 |
Visiteurs: 12692
Vie du site:
Sa conception: Juillet 2007
Son actualisation: Mai 2010
Contre projet du Comité
Développement des transports collectifs
L'extension des zones d'habitat, sans mesure d'accompagnement à l'échelle des besoins pour les transports en commun explique, si besoin était, la saturation de la circulation automobile.
D’après le recensement de 1999, 1 134 238 habitants vivent sur le territoire de l'Essonne (+ 4,43 % depuis 1990). Notons également, qu’en 30 ans, au sein de la population francilienne, la population essonnienne a doublé en passant de 5,4 % à 10,4 % en 1999.
Lors de ce recensement, la population active en Essonne était de 562 443 dont 507 722 actifs ayant un emploi dans le département. Prenons l’exemple de la communauté d’agglomération du VAL d’ORGE , où à ce jour, 60,9 % des actifs travaillent dans le département , 19,9 % en Ile de France , 18,6 % dans la capitale et 0,6 % seulement en dehors de l’Ile de France .
Le repli des emplois dans le tertiaire et l'industrie, à la périphérie de PARIS, a conduit depuis 1977 à une explosion des déplacements motorisés dans la petite ceinture et la grande couronne, atteignant respectivement 76 % et 87 % environ des déplacements. D’où une migration journalière qui s'effectue, matin et soir, entre les essonniens qui vont travailler dans la capitale et ceux qui font le trajet en sens inverse (files interminables d'automobiles avec une seule personne à bord : le conducteur). Sont inclus également, ceux qui, pour aller d'une banlieue à une autre, dans l’axe transversal du département, passent malheureusement par PARIS intra-muros ( point de passage quasi obligé des axes principaux de circulation )
Pour combattre cet état de fait, il y a bien le covoiturage mais il peine encore à s’imposer dans le monde individualiste de l’automobile. Par contre l’auto-partage ou libre service, devrait faire émerger une nouvelle culture du déplacement de proximité.
Par insuffisance des transports en commun dans l’Essonne, la voiture s'impose donc comme le moyen de transport inéluctable. Reprenons comme exemple la communauté d'agglomération du VAL d'ORGE, pour noter que la voiture, à ce jour, est utilisée par les actifs de la communauté d’agglomération à 73 % alors que les transports en commun ne le sont qu’à 18,9 %
Le constat est toujours le même : les encombrements ne découlent pas de l'infrastructure routière, mais de la carence des moyens de transports collectifs. Nombreux sont ceux qui depuis de nombreuses années, réclament des transports en commun cohérents, rationnels et à énergie propre.
Ainsi, plus qu'une priorité, la solution passe obligatoirement par le développement, l'adaptation, la modernisation, l'attractivité et l'efficacité des réseaux de transports collectifs, en particulier pour les liaisons inter- banlieue, dans l'axe transversal du département.
Les liaisons et connexions inter- modales (bus/R.E.R., bus/bus etc...) souffrent d'horaires inadaptés (fin de soirée et week-end) de certaines destinations insuffisamment desservies et du temps de trajet jugé trop élevé.
L'amélioration de ces réseaux collectifs permettrait un report non négligeable, de la voiture particulière sur les transports en commun, pour les déplacements domicile – travail et, notamment pour les déplacements de proximité (commerces, santé, éducation, loisirs, etc...).
Ajoutons enfin, que si la part des transports collectifs en ILE de FRANCE est majoritaire à PARIS avec 61 %, elle n’est que de 57 % entre PARIS et le reste de la région et 15 % seulement, pour les liaisons de banlieue à banlieue
Haut de page